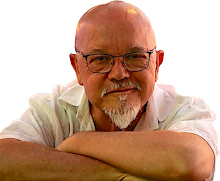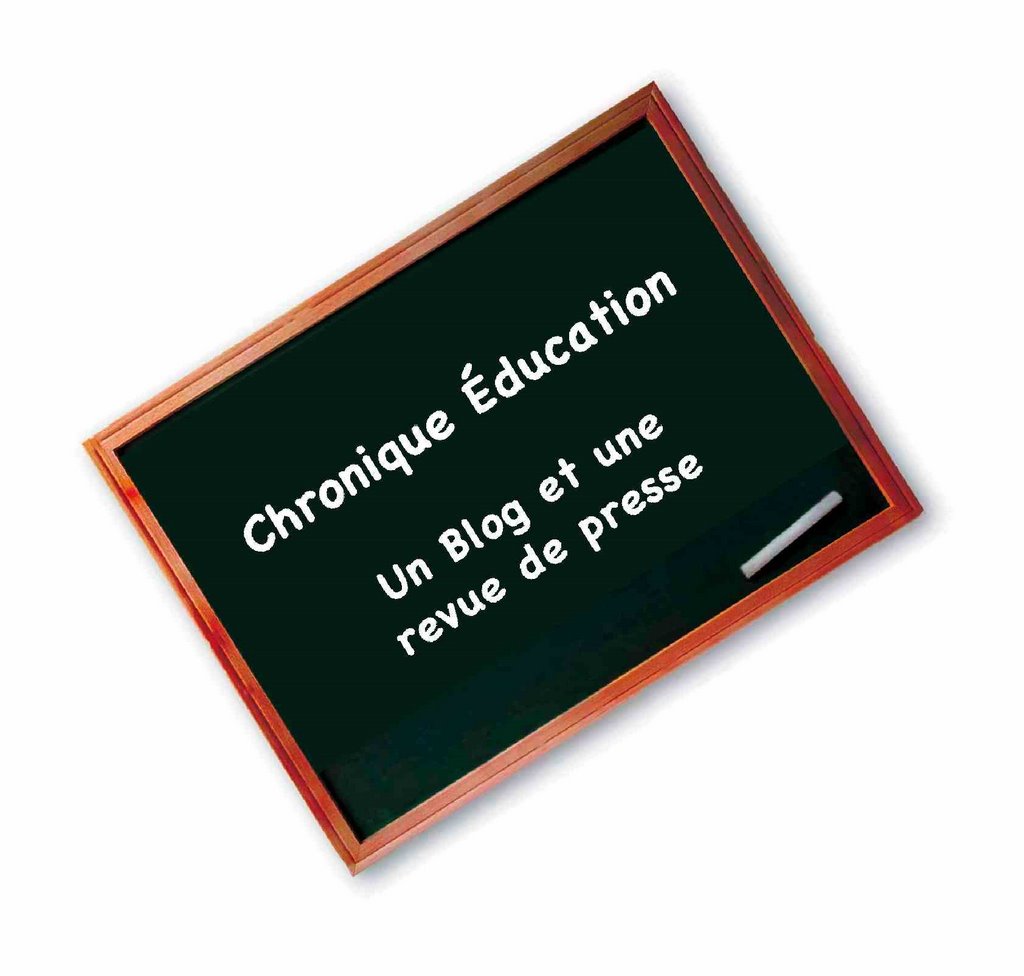Les enseignants sont de plus en plus nombreux sur Twitter et sur les
réseaux sociaux d’une manière générale. Mais la manière dont ces réseaux
évoluent, les comportements et les idées qui s’y expriment ont de quoi inquiéter. La séquence autour de
la réforme du Collège qui n’en finit pas a exacerbé l’agressivité et donne une
image inquiétante de notre profession. Les tweets
(gazouillis en anglais) donnent une musique de moins en moins agréable...
Ce billet de blog est d’abord un sincère coup de gueule et
un appel à la raison. Même si je crains qu’il soit, comme les autres,
interprété avec malveillance, fasse l’objet de moqueries et ne convainque que les convaincus…
Gazouillis…
 |
| Image extraite du clip de Stromae “Carmen”… |
Je me suis inscrit sur Twitter en avril 2009. J’ai du y publier plus de 16 000
tweets et j’ai plus de 7500 abonnés. Pourtant aujourd’hui, j’y vais à reculons.
Je n’aime plus Twitter. Je n’aime pas ce que ce réseau social est devenu.
Pour l’essentiel, ce que je fais sur Twitter comme sur
Facebook et d’autres réseaux sociaux, c’est de la “veille” sur les sujets liés
à l’éducation. Je mets des liens vers les articles, les billets de blogs, que je peux lire, que je trouve intéressants et qui
peuvent susciter le débat. Pour résumer cela en une formule qui s’applique aussi
à l’action des Cahiers Pédagogiques depuis leur création, il s’agit de « donner à penser, donner à agir ». Cela veut dire aussi que le
questionnement fait partie intégrante de la démarche. Il ne s’agit pas de donner le
dogme d’une chapelle mais de permettre à chacun de se faire son opinion.
Bien sûr, je me sers aussi des réseaux sociaux
comme d’une tribune. Je relaie les publications des Cahiers Pédagogiques et
j’informe de mes propres publications sur mon blog ou d’autres sites.
Ce que j’ai apprécié sur les réseaux sociaux c’est que la
dimension de mutualisation et d’échanges y est forte. Peut-être devrais-je écrire “était” tant
les choses ont changé au cours de cette dernière année et notamment depuis
l’annonce de la réforme du
collège. Même si les dérives de l’Internet existaient bien avant et étaient
déjà bien repérées.
Gribouillis…
 |
| Image extraite du clip de Stromae “Carmen” |
J’avais créé dès le milieu des
années 90 une dizaine de listes de discussion
professionnelles sur de nombreux sujets (SES, ECJS, TPE, etc.). Et j’ai créé un
blog dès 2004. Et déjà en 2008, j’écrivais un billet qui avait pour titre
« Débat sur l’École : Pourquoi tant de
haine ? ». A l’époque, j’évoquais surtout les débats sur les
forums et dans les commentaires des premiers blogs consacrés à l’éducation. Et
je dénonçais déjà l’anonymat
de
celui qui, tout seul derrière son clavier, s’autorise à être agressif. En
m’appuyant sur ce qu’on pouvait observer des listes de discussion, je
constatais que «
L’ “avantage”
d’Internet c’est qu’il n’est pas nécessaire d’être nombreux pour parvenir à
imposer cette intimidation. Il suffit qu’une ou deux personnes mal
intentionnées se donnent la réplique et se fassent écho en inondant les
commentaires d’un blog ou les listes pour donner l’illusion du nombre et
dissuader ceux qui voudraient intervenir mais qui n’ont pas le goût ni le temps
de la polémique de le faire.» J’ai aussi exprimé ma
stupéfaction devant les dérives verbales
qu’on
pouvait trouver sur le forum néoprofs (malgré les tentatives de
modération), ce qui m’avait valu une rancune tenace de certains des
protagonistes.
Les dérives ne sont donc pas nouvelles. Et elles ne sont pas
non plus spécifiques au monde de l’éducation. Il y a eu déjà de nombreux
articles sur le phénomène des “haters”
(les “haineux” ou “haïsseurs”…) qui occupent les réseaux sociaux et les
commentaires des articles en y déversant leur bile et souvent aussi leur
racisme. L’internet est devenu laid…
Le media qu’est Twitter avec sa forme spécifique n’a fait
que renforcer cette dimension. Comment débattre, argumenter, nuancer, en 140
caractères ? La forme est propice à la punchline
et au comportement de sniper pour
reprendre des termes anglo-saxons. Autrement dit, c’est plus facile de faire une
vanne, un bon mot, d’interpeller et de flinguer que de chercher à discuter. En
tout cas, ce format ne permet pas la nuance.
Cafouillis…
Dans le domaine de l’Éducation, les échanges très virulents
ne sont donc pas neufs mais ils ont pris une tout autre ampleur et ont même
changé de nature avec la réforme du collège.
Lorsque la réforme a été présentée le 8 mars dernier,
cela s’est fait dans une quasi-indifférence. Mais très vite le ton a monté et le
débat a pris une ampleur inédite dans la Presse et dans les réseaux sociaux.
J’ai essayé de rendre compte de cette longue séquence avec mon bloc-notes
hebdomadaire de l’actualité éducative. Plusieurs éléments ont contribué à
échauffer les esprits. D’abord la réforme elle même a été perçue par un certain
nombre d’enseignants comme une remise en cause de leurs conditions de travail
et de leur identité professionnelle. C’est particulièrement le cas pour les
enseignants de Lettres Classiques qui se sont sentis menacés ainsi que les professeurs
de langues vivantes. Mais plus globalement, c’est l’interdisciplinarité qui a
été vue comme une soustraction des heures propres à chaque discipline et donc
une dégradation des conditions de travail.
Sur le plan du dialogue social, à la fermeté du ministère
lors des négociations a répondu
un
départ des discussions de certains syndicats. Mais c’est surtout la
publication du décret d’application le lendemain de la manifestation du 19 mai qui a été
vécue comme une provocation. Le sentiment de ne pas être entendu a été
entretenu au cours de ce début d’année avec des sondages montrant une hostilité
des enseignants et de l’opinion à cette réforme. Les Unes catastrophistes du “
Figarianne” et de “
Valeurs du Point actuel” n’ont fait qu’accentuer encore les
clivages.
Zizanie…
Il y a aussi une variable syndicale qu’il faut évoquer. Tous
les syndicats n’ont pas envisagé les réseaux sociaux de la même manière et
surtout avec la même rapidité. Le SE-UNSA par exemple avait inscrit très tôt dans
ses résolutions de congrès la nécessité de s’investir dans les réseaux sociaux
(Le CRAP-Cahiers Pédagogiques a aussi
pris très tôt ce tournant numérique). Mais avec #college2016 on a vu débouler
de nouveaux acteurs et en particulier le SNES qui est arrivé en force sur
Twitter. Et pas toujours en en respectant les codes jusque là en vigueur
(mutualisation, partage de liens,...). La vielle rancune entre ces deux syndicats
(SNES et SE-UNSA issus d’une scission) n’a rien arrangé et a conduit à une
surenchère réciproque.
Dans cette guérilla, il y a aussi l’enjeu du nombre et de la
représentativité. Le vote au CSE sur le collège a été adopté à la majorité mais
les syndicats opposés à la réforme considèrent qu’ils représentent quant à eux
la majorité des enseignants. Et l’effet de loupe de Twitter où les pro-réforme
étaient nombreux a agacé les opposants qui ont voulu bien maladroitement
montrer qu’ils étaient eux aussi nombreux sur ce réseau social.
On retrouve aussi dans ces attaques permanentes les vieilles
rengaines sur les permanents syndicaux qui ne seraient plus sur le
« terrain » et seraient “hors-sol”. Pour remettre en contexte cette
vieille accusation, que j’ai moi même subie, il est surprenant de l’entendre
chez des syndicalistes car la fonction même d’un corps intermédiaire comme le
sont les syndicats (ou les mouvements pédagogiques) est de recueillir et
d’agréger les informations qui remontent des adhérents. A priori un
représentant syndical ne représente pas que lui même ! Cela en dit long
sur la représentation que l’on peut avoir de ces corps intermédiaires. Par
ailleurs, si certains syndicats peuvent se permettre de préserver quelques
heures de cours pour leurs permanents c’est parce que leur nombre de décharges
est important (elles sont distribuées en fonction des résultats aux élections
paritaires). D’autres organisations avec moins d’heures peuvent faire d’autres
choix.
L’aspect syndical est complété par des postures politiques. Dans
un contexte général de morosité et de radicalisation des positions, à la
lecture de certains messages on ne sait plus bien si l’objet de cette
exaspération est la réforme du collège ou plus largement la politique du
gouvernement. Les deux se confondent. Comme souvent en France, on se préoccupe
moins de ce qui est dit ou proposé que de qui le dit ou le propose. Avec ce
prisme partisan, il semble inconcevable pour certains que les militants
pédagogiques puissent se réjouir que des idées pour lesquelles ils militent
depuis longtemps puissent être reprises dans un projet gouvernemental sans que
cela fasse d’eux des “suppôts” du gouvernement.
Ce qui est vraiment déplorable avec ces zizanies syndicales
et politiques et la surenchère qui en découle c’est qu’elle a interdit la
nuance. Des deux côtés. Une opposition mesurée ou un soutien critique semblent
aujourd’hui interdites. Et c’est bien dommage…
Embrouillaminis…
Très vite, le réseau a alors été utilisé pour interpeller
systématiquement ceux qui étaient favorables à la réforme qui ont (à tort à mon
avis, vues les conditions propres à Twitter décrites plus haut) tenté de
répondre.
Une interpellation vécue souvent comme du harcèlement
d’autant plus qu’elle a rapidement été accompagnée de moqueries et de
caricatures. Chacun s’est très vite senti insulté et “méprisé”. “pédagogistes fous” ou “jaunes” ont été utilisés d’un côté. Je
pense, qu’à l’inverse, l’emploi de termes tels que “conservateurs” (même s’ils
peut sembler anodin) et a fortiori de “réactionnaires” ont été vus comme des
insultes et des caricatures. L’accent mis sur l’aspect hétéroclite des
opposants a été vu aussi comme un amalgame insultant.
Comme dans les cours de récréation où on accuse “c’est lui qui a commencé…” et où on dit
qu’“on arrêtera quand les autres
arrêteront”, il est tentant de jouer les arbitres.
 |
| Image extraite du Clip de Stromae “Carmen” |
Il est délicat pour moi de jouer ce rôle. Il m’est arrivé,
moi aussi, quelquefois de tomber dans le piège de l’escalade verbale. Et même
mon bloc-notes où j’analysais la situation avec le prisme de la revue de presse
a été vécu comme une agression et la posture d’un “donneur de leçons”... Ma présence dans la presse a fait aussi de
moi, à mon corps défendant, avec quelques autres une sorte d’incarnation de la
réforme. L’homme qu’on aime détester...
Ce qui n’est pas toujours facile à vivre et qui m’a permis
de me rendre compte à ma petite échelle de ce que peuvent subir les personnages
publics soumis aux “haters” et à la
rudesse de ce qui n’est plus alors un débat.
Dégueulis…
Il y a quelques mois, cela m’a valu un “compte parodique”
(je l’avais évoqué
dans
un de mes bloc-notes) où on se moquait de moi. Il s’agissait semble t-il
d’une initiative individuelle. Ce compte a été fermé depuis. Mais,
régulièrement, on peut voir des insultes ou des moqueries qui touchent des personnes
qui publient sur Twitter : moqueries sur le nom ou sur ce qu’elles
proposent,... Cela confine à une forme de mise au pilori.
A tel point qu’on peut se demander si
avec de telles pratiques, il ne s’agit pas tout simplement de chercher à les
faire taire…
L’argument de “l’humour” utilisé pour justifier ces
pratiques trouve vite ses limites. Celui-ci s’applique d’abord à soi même. Ici
on est plutôt dans l’ironie et le sarcasme. Et l’excuse du “c’était pour rire, t’as pas d’humour” évoque trop l’argument utilisé dans les
bizutages, harcèlements et autres dérapages adolescents.
Car il faut bien le dire, tout cela rappelle ce qui se joue
dans les cours de récréation et dans les réseaux sociaux entre jeunes. Sauf
qu’ici on est avec des adultes supposés justement avoir, sinon un comportement
exemplaire, du moins une action éducative auprès d’eux. Que penseraient nos
élèves ? Quelle image donnons nous collectivement de la profession ?
Je sais bien que ce ne sont que des paroles mais pour des
enseignants qui sont des gens du “verbe" et qui accordent de l'importance
aux mots, toutes les barrières, toutes les auto-censures ont été franchies par
certains.
Les mots sont importants. Lorsque certains (dont un ancien
Recteur) parlent d’ « esprit de
collaboration » à propos des “pro-réforme” et de “jaunes” pour qualifier ceux qui s’engageaient dans la formation,
lorsque d’autres évoquent le “chômage”
de telle ou telle catégorie d’enseignants, on se dit qu’on a perdu le sens des
mots. De même, le fait d’être opposé à la réforme ne fait pas forcément de vous
un "réactionnaire"..
Dernièrement on a vu aussi de nouveaux comportements
apparaitre. Ainsi, lorsqu’une collègue a lancé une balise #EPIpartage afin de
mutualiser des idées d’enseignements pratiques interdisciplinaires, cela a
donné lieu à un niveau d’attaques jamais atteint jusque là avec un “humour”
plus que douteux. “Mon corps me raconte une histoire” devient la biographie du
pétomane... De même un enseignant
a
publié sur Twitter deux textes très critiques, l’un sur la collègue à
l’origine d’#EPIpartage et l’autre à l’égard de Mila Saint Anne. Il utilise un
procédé (
déjà
employé par Loys Bonod) de découpage systématique du texte et critique sur
chaque point de phrase dans une intention extrêmement malveillante. Pour moi,
qui
ait déjà écrit que l’on devrait être capable de critiquer mutuellement nos
travaux dans un esprit de “dispute” professionnelle, ces textes montrent
exactement l’inverse de ce qu’il faudrait faire : on n’est pas dans le
face à face et il n’y a aucune bienveillance et esprit constructif dans ces
écrits.

Et ce qui est le plus inquiétant dans
l'histoire c'est que cela va à l'encontre de la culture jusque là dominante
dans les salles des profs. A savoir que par "esprit de corps" on ne
remet pas en cause l'enseignement d'un(e) collègue. Critiquer était jusque là
perçu comme étant de l'ordre de l'agression. Et cela était un dogme poussé
jusqu'à l'extrême. A tel point que cela aboutissait quelquefois à défendre des
situations très “limites” D'une manière générale, chez les enseignants et en
particulier les plus conservateurs la “liberté pédagogique" est érigée en
valeur voire en tabou. Mais cette liberté semble à géométrie variable car si
elle est proclamée pour ceux qui ne veulent pas changer, elle est refusée à
ceux qui innovent ou qui appliquent les textes !
Un mot aussi sur ce qui justifie ces
débordements d'insultes et d'agressivité. “On” nous dit que c'est en réponse à
une agression inverse de la part du ministère et de ses thuriféraires (les
pédagos). Et que l'exaspération, la "colère", le "mépris"
ressenti justifieraient tout.
Se sent méprisé, se sent injurié qui
veut bien l’être. Aujourd’hui, dans un contexte de déclassement des enseignants
et avec le sentiment de se sentir remis en question dans son identité, la
crispation est forte. Et l’exaspération vient vite. Mais comme tout sentiment, l’agression,
l’exaspération devraient être questionnées et relativisées. C’est aussi ce que
l’on demande à nos élèves !
J'ai quelquefois utilisé l'expression
d"'imaginaire prolétarien"
qui agace beaucoup certains de mes lecteurs. Mais c'est malheureusement aussi cela
qui me vient quand je lis certaines des justifications dans les discours les plus “radicaux”. On semble,
dans une sorte de scène fantasmée où des fonctionnaires de la classe moyenne “rejouent”
la révolte des prolétaires face à un patronat qui opprime et des syndicats
"jaunes” qui seraient à la botte de ce “patronat”. Et au nom de cette supposée
oppression toutes les violences (verbales) seraient alors acceptables ? De l’opposition
normale à une réforme, on est passé à une sorte de délire intolérant...
Car ce qui est finalement le plus
inquiétant pour le militant pédagogique que je suis, c’est la remise en cause
très agressive des valeurs, des convictions et des pratiques qui sont les
nôtres.
Les valeurs sont remises en cause. On
a bien vu derrière le débat sur le collège que cela fait remonter à la surface
des choses pas très claires. La critique de l'“égalitarisme”, il faudra qu'on
m'explique mais si on gratte un peu ce que ça veut dire n'est pas très joli. Et
dans bien des discours, l'élitisme n'est même plus affublé de l'adjectif
"républicain"...
Il y a aussi la remise en cause des
sciences de l'éducation et plus particulièrement du constructivisme. Il ne
s'agit pas de dire que tout le monde était "converti" au constructivisme
mais jusque là sa remise en cause était discrète et se situait surtout dans les
pratiques mais peu au niveau du discours. Aujourd'hui, sur ce point aussi, des
bornes sont franchies. Les méthodes actives, la démarche de projet, l'idée même
que les élèves puissent être acteurs dans la construction du savoir tout cela
est nié aujourd'hui dans les déclarations qu'on peut lire non seulement sur
Twitter mais aussi sur des textes plus longs et plus structurés. C'est le
retour des “fondamentaux”, de la défense du cours magistral, d'une pédagogie
très linéaire et de la répétition comme principal moyen d'apprendre. Et cela
n'est pas réservé à quelques “conservateurs” classiques mais se retrouve
exprimé dans tout le spectre syndical. Non seulement on moque les
“pédagogistes” car ils sont considérés comme des soutiens du ministère mais
aussi et surtout parce qu'on considère que leurs pratiques et leurs théories
sont “fumeuses”. Et cette intolérance va aujourd’hui au delà du débat d’idées
pour se situer dans le registre de l’agression. Cela m'inquiète…
Bisounourseries…
J’ai utilisé des mots forts
pour m’exprimer. En parlant de “dégueulis”, je succombe moi aussi à la
provocation. Et je sais déjà que cela me vaudra en retour des attaques et des
indignations où on criera au mépris et à l’insulte…
J’ai voulu dire que cette séquence
sur le collège a révélé des tensions et des clivages qui sont très inquiétants.
Je suis inquiet pour ma part d’une
parole qui s’est libérée dans les réseaux sociaux et de sa violence implicite. Reste
à savoir si elle peut se réduire et surtout si elle se limite à ce microcosme
qu’est Twitter ou si elle peut se répandre dans les salles des profs.
Pour ma part, sur Twitter, j’essaye
maintenant de m’astreindre à quelques règles. Je suis persuadé aujourd’hui que
chercher à convaincre et même débattre en 140 caractères est une impasse. Les
interpellations pratiquées par certains sur les articles que je signale ne
servent à rien. Je connais leur désaccord et je les invite à publier des
articles sur leurs blogs respectifs et à en signaler l’existence. Au départ,
Twitter pour les enseignants servait à ça…
Je continuerai à me préserver
en “bloquant” ceux qui m’interpellent de manière systématique et agressive. Et tant pis si certains crient à la
“censure”, comme je l’ai déjà écrit, je n’ai simplement pas envie d’interagir
dans un tel climat.
J’espère aussi que les
responsables syndicaux quels qu’ils soient vont comprendre que de tels
agissements desservent plus qu’ils ne servent la cause qu’ils défendent. Et que
l’image des enseignants n’a pas besoin de telles dérives.
Il faut prendre garde aussi à
ne pas surestimer ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il faut en effet se
méfier de l’effet de lampadaire que Twitter génère alors que les journalistes et
politiques sont très friands de cet espace. En intitulant mon texte ainsi je
veux dire aussi que si le pire (le “dégueulis”) s’est développé, le meilleur
continue à exister. Cela peut être encore un espace de partage d’informations
et même de mutualisation.
Et surtout, (c’est le
moment Bisounours…), je reste convaincu
que, loin des discours, loin des clivages surjoués et entretenus, loin de cette
atmosphère de guérilla permanente où l’on consacre beaucoup d’énergie à jouer
les “GrainS de sable”, on peut trouver aussi dans les établissements de
l’énergie positive pour élaborer ensemble, éventuellement critiquer de manière
bienveillante et constructive. Et se donner collectivement du pouvoir d’agir.
Philippe Watrelot
Le 1er novembre 2015
Note : ce
billet de blog est en chantier depuis une dizaine de jours. L’idée est bien
antérieure à la parution de l’article de Christel Brigaudeau dans Le Parisien
le 30 octobre intitulé
“Réforme des collèges : les profs
s’étripent sur le Net”. La sortie de cet article m’a amené à retarder
la publication de ce billet.
En complément :
quelques liens