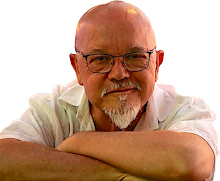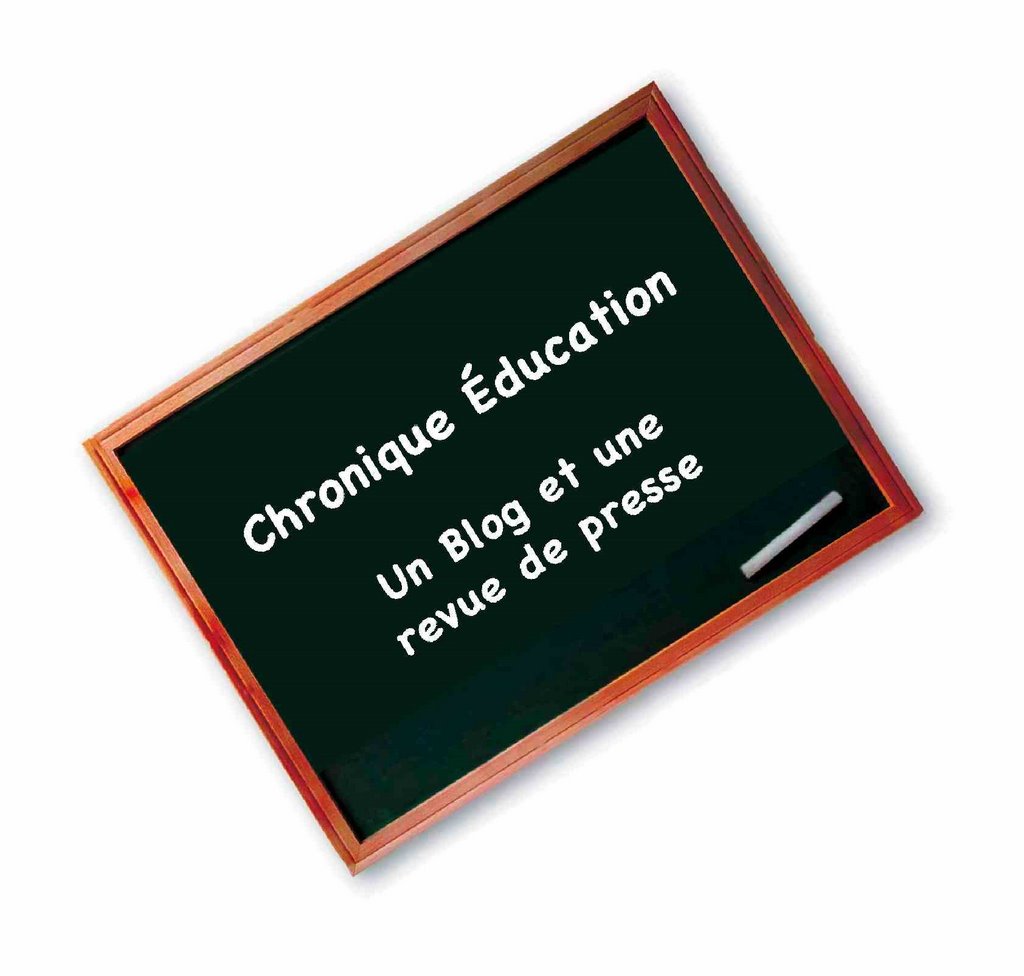- Souverains poncifs – assassins du journalisme – merci Patron - Lectures - .
Le bloc notes revient sur le pape et ses souverains poncifs. On constatera que sa remarque s’inscrit dans une stratégie délibérée de relance de la polémique sur une supposée “théorie du genre”. Et les hommes politiques de droite s’en sont eux aussi emparés à la suite des propos de la ministre.
«Qui sont les assassins du journalisme ?» c’est la question que nous nous reposerons à propos du livre de Carole Barjon qui bénéficie d’un large soutien médiatique. On évoquera aussi la situation de l’enseignement des SES et on finira par quelques lectures et un antidote pour survivre à tout ce qui empoisonne le débat sur l’École.
Souverains poncifs
Quand il prend l’avion, le pape ne manque pas d’air...
Le pape François a accusé, dimanche 2 octobre, les manuels scolaires français de propager un « sournois endoctrinement de la théorie du genre» . S’exprimant devant les journalistes dans l’avion qui le ramenait à Rome après trois jours dans le Caucase, le pontife argentin a raconté une anecdote rapportée par un père de famille français. Selon le pape, ce père de famille catholique a raconté comment son fils, interrogé pendant un repas de famille sur ce qu’il voulait faire plus tard, lui avait répondu : « Etre une fille.». « Le père s’est alors rendu compte que dans les livres des collèges, la “théorie du genre” continuait à être enseignée, alors que c’est contre les choses naturelles », a déclaré le pape.
Cette déclaration pour le moins hasardeuse et qui sent l’intox relance un poncif maintes fois répété. Un petit tour dans les archives de mon blog nous rappelle que la supposée “théorie du genre” ne cesse de revenir dans l’actualité. Elle trouverait son origine nous disait le sociologue Éric Fassin en 2014 dans un Lexique du Vatican publié en 2005. En juin 2011, un article du Figaro , déjà très mobilisé sur cette question, nous informait que l’église catholique s'inquiétait de l'introduction en première de la «théorie du genre» en SVT, contestant les différences homme-femme. Christian Jacob, Président du groupe UMP à l’Assemblée nationale, demandait une mission parlementaire sur les livres scolaires. 193 parlementaires UMP adressaient une lettre au Ministre de l’époque, Luc Chatel demandant le retrait des manuels scolaires de SVT de classe de première L et ES. Et en janvier 2014, on remettait des sous dans la machine avec l’emballement autour des «journées de retrait de l’école» (JRE) qui venait elle même après la manif pour tous et le collectif Vigi-gender qui en ont fait un thème de mobilisation.
“Une rumeur unique en son genre” titrait Libération le 30 janvier 2014. En tout cas, une rumeur savamment entretenue et qui est tout sauf spontanée. 20.000 écoles ont d’ailleurs reçu en septembre une brochure «anti-genre» édité par le collectif VigiGender, nous dit Le Figaro . La brochure se penche plus particulièrement sur les programmes de sciences de la vie et de la terre (SVT) datant de 2010, sur un manuel d'éducation morale et civique (EMC) de 2016 et sur deux manuels de SES datant de 2014. Ce collectif rapporte aussi des extraits d'interviews de Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem et Vincent Peillon, lesquels auraient dit que «l'Éducation vise à arracher les enfants aux déterminismes sociaux et religieux». Rappelons aussi que la Manif pour tous prépare une nouvelle manifestation le 16 octobre prochain.
Suffit-il de répéter sans cesse un mensonge pour qu’il devienne une vérité ? La relance par le Pape nous rappelle en tout cas à un devoir de vigilance. Même si c’est fatiguant...“Au risque de radoter, « la théorie du genre » n’existe pas ”. Ce titre d’un article de Rue89 résume assez bien les principaux arguments à rappeler face toutes ces contre-vérités sans cesse répétées. La meilleure preuve en est que cet article a été initialement publié en juin 2013 ! On pourra lire aussi une exploration de ce que disent vraiment les manuels scolaires par L’Express et par La Croix. On pourra lire aussi une mise en perspective intéressante dans le Huffington Post
La ministre de l’éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a pour sa part réagi, dès le lundi 3 octobre sur France Inter, aux allégations du pape François, regrettant “une parole légère et infondée” et ajoutant : “Je n’imaginais pas que le pape François se laisserait embarquer par des intégristes et leur folie mensongère. Ça me met en colère.”. Elle a aussi invité le chef de l’Eglise à “venir rencontrer les enseignants en France” ; “Dans les manuels, on parle de la nécessité de ne pas hiérarchiser entre un genre et un autre ”, a-t-elle précisé.
Cette déclaration nous permet de coupler ce thème avec notre feuilleton hebdomadaire sur les déclarations de la droite. Car, dès la fin de l’émission, on a eu droit à un déchainement sur le thème “Touche pas à mon pape avec Éric Ciotti et Christian Estrosi en chefs d’escadrille... Et ce ne sont pas seulement les seconds couteaux qui se sont lâchés. Laurent Wauquiez, le président (par intérim) de Les Républicains, se livre à un mensonge éhonté en déclarant : “Que Najat Vallaud-Belkacem ne fasse pas preuve d'hypocrisie. Il est connu et c'est connu que c'est une défenseure de la théorie du genre. Elle s'est plusieurs fois exprimée dessus. ”. Nicolas Sarkozy de son côté a lancé “ Mme Najat Vallaud-Belkacem aurait mieux fait de se taire, elle nous fait honte.” Et François Fillon, pour ne pas être en reste s’est, quant à lui, déclaré choqué “qu'on interdise au pape de s'exprimer”. Seule ou presque, Nathalie Kosciusko-Morizet a estimé pour sa part que “le pape est allé un peu vite en besogne ”.
Et Bruno Le Maire ? Pendant ce temps là, il était occupé à soutenir une école privée de la Fondation Espérance Banlieues à Asnières. Une école financée par des grands groupes privés et aux méthodes très traditionnelles voire traditionnalistes avec uniforme, lever des couleurs et salut au drapeau.
C’était donc notre rubrique : “les primaires de la droite et du genre”...
Assassins du journalisme
On se souvient, il y a quinze jours, de la parution d’un article dans Le Point avec huit visages alignés sur deux rangées avec leur nom et une courte présentation et en titre “Ils ont tué l’école !”. Il s’agissait d’une recension du livre de Carole Barjon “Mais qui sont les assassins de l’École ?” . Dès sa parution, ce livre a suscité des réactions tant le propos est outrancier. L’actualité (et l’indignation) en est relancée cette semaine avec deux publications.
C’est d’abord, rien de moins qu’une chronique de Laurent Joffrin, le directeur de Libération intitulée “Pourquoi nos enfants ne savent plus lire ”. Le médiatique journaliste connu pour avoir un avis sur tout se livre à une critique très élogieuse du livre de sa consœur de l’Obs qu’il qualifie d’“enquête journalistique sérieuse”. Selon lui, “elle livre un diagnostic vivant et précis de l’apprentissage de la langue française par les élèves de la République. Le résultat est effrayant ”.
On peut se dire que cette chronique de Joffrin relève avant tout du copinage et du renvoi d'ascenseur entre professionnels de la profession. Joffrin a du faire l'aller-retour Obs-Libé 2 ou 3 fois...Mais on peut aussi considérer que cet article dans Libération à propos d’un livre d’une journaliste de L’Obs (deux publications jusque là plutôt considérées comme progressistes voire de “gauche”) marque une date dans la victoire idéologique d'un certain courant.
Face à cet ouvrage qui a eu aussi les honneurs de France Culture , les réactions s’organisent. C’est le cas avec une pétition (sur Change.org) qui dénonce “le choix de la calomnie”. On pourra lire aussi le billet de blog (nuancé ce qui est à souligner) de Paul Devin sur Médiapart qui se demande “à qui profite le discours outrancier sur l’école ?”.
Sur le site des Cahiers Pédagogiques, Jean-Michel Zakhartchouk se livre à une recension de ce livre qu’il considère comme “une véritable ignominie”. D’abord par son titre mais aussi par ses méthodes, car “elle dresse un réquisitoire basé essentiellement sur des lectures orientées” et elle “s’appuie sur des anecdotes et déclarations peu vérifiables, et sur des interprétations à partir d’entretiens biaisés avec des « assassins », prenant comme axe de lecture le relevé de tout ce qui apparaitrait comme de la « repentance » et de l’autocritique.”. On trouvera à la suite de cette analyse très détaillée, le témoignage de François Dubet sur l’entretien qu’il a eu avec la journaliste et le sentiment qu’il en retire d’une volonté de manipulation.
Je n’ai pas pour ma part lu le livre (et je n'ai pas trop envie, mais bon...) mais je ne pense pas qu'on fasse avancer le débat sur l'école comme elle prétend vouloir le faire en désignant des "assassins" de l'école. Le procédé est indigne. Par ailleurs, on a l’impression que ce qui s’y trouve ne relève pas d’un constat objectif et documenté, mais d’une lecture très partisane et à vrai dire biaisée. Elle semble donc mal informée et peu rigoureuse sur un sujet qu'elle maîtrise mal (comme beaucoup de journalistes généralistes et éditorialistes) mais elle bénéficie de réseaux qui lui permettent de compenser cela par une belle couverture médiatique. Tout cela ne fait pas honneur au journalisme (s'il y avait des "assassins du journalisme” peut-être serait elle sur la liste...)
Merci patron !
Je voudrais m’attarder sur une information qui est peut-être passée inaperçue (sauf pour un prof de SES). C’est le journal Les Échos qui nous apprend que les cinq chefs d'entreprise siégeant en tant que personnalités qualifiées viennent de claquer la porte du Conseil national éducation-économie (CNEE). Cette instance avait été installée en octobre 2013 par le Premier ministre d'alors, Jean-Marc Ayrault, pour rapprocher l'école de l'entreprise.
Selon Les Échos ainsi que le magazine Challenges, ce départ serait lié à deux motifs. D’abord l’allègement du programme de SES de Seconde où le chapitre « Comment se forment les prix sur un marché ? » a perdu son caractère obligatoire. Il y aurait aussi une obscure raison liée au refus du ministère de mettre à disposition un rapporteur pour une mission sur l’apprentissage.
J’avais essayé de montrer dans une tribune pour AlterEcoPlus combien cette polémique sur le marché était surjouée et sans fondement. C’est plutôt un prétexte. Le leader du groupe des démissionnaires, Michel Pébereau (ancien haut fonctionnaire passé ensuite par BNP-Paribas) est dans une sorte de vendetta depuis des années à l’égard des programmes et des enseignants de SES. Avec cette démission et cette dramatisation, nous sommes face à une stratégie du pourrissement avec en ligne de mire la volonté de s’appuyer sur l’alternance pour en finir avec cet enseignement
Car, les programmes de SES ont le triste privilège (partagé avec l’histoire... ?) de ne pas relever de la seule indépendance du Conseil Supérieur des Programmes (qui a normalement été créé pour ça). Face à la pression des lobbys patronaux et de l’Académie des Sciences morales et politiques, le ministère avait saisi conjointement le CNEE et le Conseil supérieur des programmes (CSP) d'un avis - attendu pour fin janvier - qui porterait sur les trois années de lycée de la filière de sciences économiques et sociales, et pas seulement sur la classe de seconde. Cette concession pouvait permettre de sortir par le haut de cette polémique. La dramatisation tente, en définitive, de bloquer cette démarche paritaire. On peut espérer que l’on parvienne malgré tout à un débat plus serein, loin des acharnements idéologiques et des caricatures !
Lectures et écoutes
Quelques lectures pour finir...
Et commençons d’abord par la lecture des élèves. La plateforme LireLactu, qui met gratuitement à disposition des élèves et enseignants la presse quotidienne nationale, a été lancée jeudi dans 80% des collèges et lycées par Najat Vallaud-Belkacem. La plateforme sera accessible à 5,5 millions d'élèves dans 14.000 établissements, sans code et sans publicité. Les articles ne pourront pas être imprimés, pour préserver le modèle économique de la presse.
Lire, ça peut être aussi écouter... Samedi 8 octobre, l’émission “Répliques” sur France Culture animée par Alain Finkielkraut recevait Philippe Meirieu et Robert Redeker avec pour thème “la crise de l’École” . Si vous voulez une sorte de condensé de tous les préjugés qu’on peut dire sur l’École, il faut écouter cette émission où Philippe Meirieu s’en est bien tiré face à Redeker (et Finkielkraut en embuscade).
Puisqu’on parle de radio, on pourra aussi écouter l’émission “le téléphone sonne” du 7 octobre consacrée au rapport du CNESCO avec Nathalie Mons et François Dubet.
Ce même François Dubet est l’auteur du deuxième numéro de la série ”Antidote lancée par les Cahiers Pédagogiques . L’objectif de cette rubrique est de lutter contre les idées reçues et autres préjugés qui abondent dans le débat sur l’éducation et la pédagogie mais aussi de déconstruire les solutions simplistes. Après un premier texte sur la fausse opposition entre bienveillance et exigence , la tribune de François Dubet s’attaque aux idées toutes faites sur l’élitisme . «On ne s’occupe pas assez des bons sous prétexte d’anti-élitisme. » est une des phrases qu’on a déjà entendues et qu’on risque encore d’entendre dans les mois qui viennent. Et il y en a bien d’autres !
Cette rubrique des Cahiers Pédagogiques proposera donc au fil des semaines et des mois un antidote à tout ce qui empoisonne le débat sur l’École. On en a besoin !
Finissons complètement ce bloc-notes avec un rappel et un hommage. Il y a 50 ans (le 8 octobre 1966) , Célestin Freinet nous quittait. Il est toujours là pourtant, à nos côtés. Car ses combats pour une école émancipatrice coopérative et qui lutte contre les inégalités sont plus que jamais d'actualité...
Bonne Lecture...
Philippe Watrelot

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France.