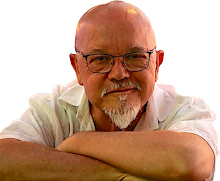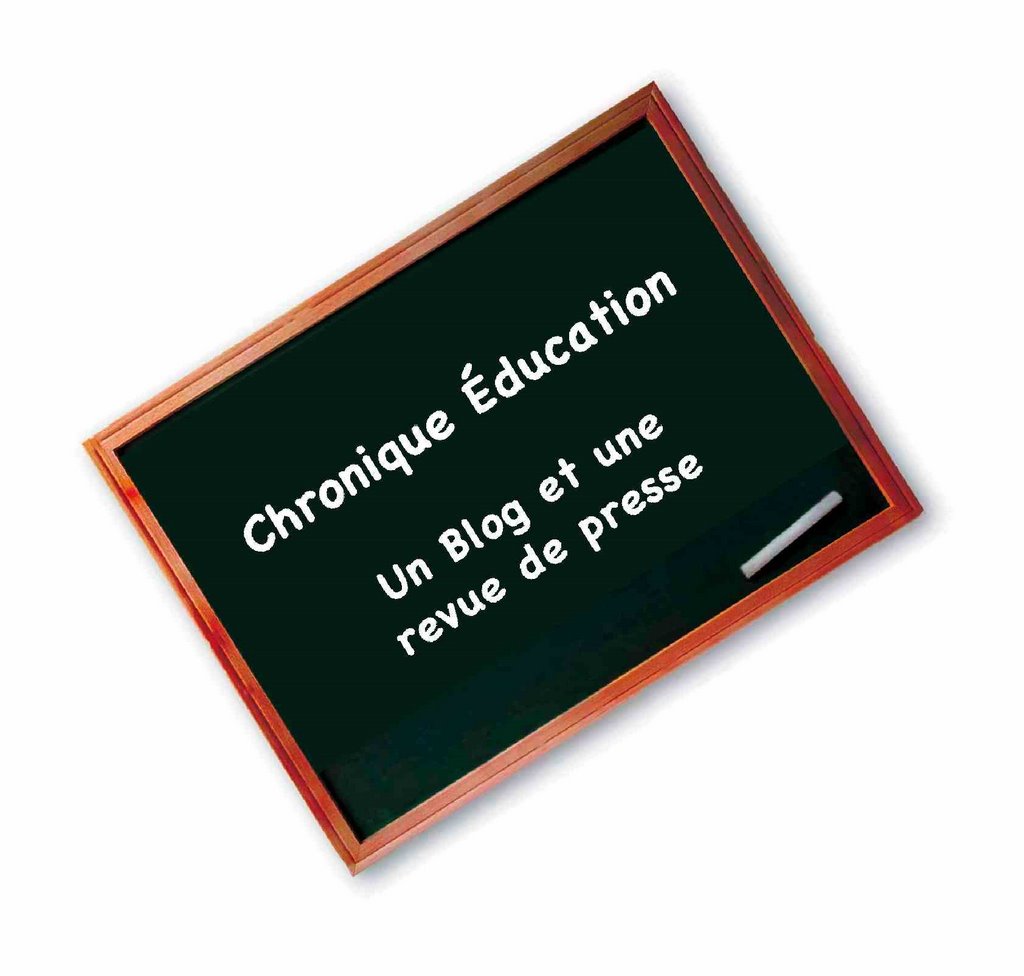Il a fallu une réforme des retraites bâclée oubliant les enseignants et surtout la mobilisation de ceux ci pour que Jean-Michel Blanquer propose en un mois un calendrier de « revalorisation » ou plutôt de compensation.
Pourtant, malgré les sommes annoncées et les promesses réitérées, chez les enseignants la confiance n’est pas au rendez vous.
D’abord parce que la parole politique et en particulier celle du Ministre a été dévalorisée et cela incite à la méfiance. Ensuite parce que ce qui est sur la table est loin de correspondre à une revalorisation au sens où beaucoup l’entendent. Enfin, parce que Blanquer veut lier les questions de pension, de salaire et de redéfinition du métier et y introduire une dose de « mérite ». Cette négociation s’accompagne donc d’une vieille obsession gouvernementale : celle des « contreparties » et du « donnant-donnant ».
Tous les ingrédients sont réunis pour biaiser la négociation et mal redéfinir un métier qui en aurait pourtant bien besoin.
Vraie-fausse revalorisation
Alors que la réforme des retraites était annoncée depuis l’élection présidentielle, on “semble” n’avoir pris conscience que tardivement que les enseignants risquaient d’être les grands perdants de ce nouveau mode de calcul. En effet, ils n’ont que peu de primes (voire pas du tout) et leur carrière qui commence tardivement est telle que ce n’est que dans les dernières années qu’ils voient leur revenu augmenter.
Mais si la question des retraites met une certaine pression pour compenser, la revalorisation ne peut se limiter à cela. Dans un précédent article, je montrais qu’il y avait plusieurs dimensions à une réelle revalorisation :
- La compensation pour maintenir le niveau des pensions de retraite compte tenu du calcul par points et du faible nombre de primes dans la profession
- Le rattrapage du pouvoir d’achat des fonctionnaires sachant que le point d’indice est gelé depuis neuf ans
- La mise à niveau des salaires des enseignants par rapport aux autres salariés français ayant des niveaux de diplôme équivalents pour retrouver de l’attractivité
- Une revalorisation du métier d’enseignant par rapport aux autres pays comme le suggèrent les enquêtes internationales.
Le gouvernement et le ministre ne découvrent pas aujourd’hui cette situation. La baisse du pouvoir d’achat des profs, la faiblesse de leur salaire en comparaison de ceux des pays voisins, la faible attractivité du métier, tout cela est connu. Depuis trois ans on avait le temps de s’en préoccuper. Mais on semble se soucier aujourd’hui du seul premier aspect lié aux retraites dans des négociations à la va-vite.
Si la presse reprend sans le questionner le terme de « revalorisation » c’est pourtant donc loin d’être le cas. Comme le dit très bien Lucien Marboeuf : « ceci n’est pas une revalorisation » !
D’après Les Échos, la loi de programmation destinée à “revaloriser” les enseignants en lien avec la réforme des retraites, attendue pour juin, pourrait s'étaler sur cinq ans, entre 2022 et 2026. Un rapport serait annexé à la loi, qui aurait valeur législative (?), et prévoirait des hausses de rémunérations sur l'ensemble de la décennie 2020.
Jean-Michel Blanquer a déjà annoncé, que la revalorisation se ferait à raison de 500 millions d'euros par an en commençant par les plus jeunes avec une hausse cumulative (1 milliard pour l'année 2, 1,5 milliard pour l'année 3, etc.) On aboutirait en cumulé à 10,5 milliards de hausse en 2026.
On devrait donc se réjouir... Pourtant les enseignants restent méfiants. « Les promesses n’engagent que ceux qui y croient » disait Charles Pasqua, et l’inscription dans un rapport ne semble pas pour beaucoup une garantie suffisante. Et de nombreux enseignants ont le sentiment que ce rattrapage va leur passer sous le nez et ne concerner que les plus jeunes et ne sera pas suffisant face aux retards accumulés.
Et puis surtout, cette négociation voit ressurgir la vieille obsession des “contreparties”.
Les contreparties : une vieille obsession
« le pacte social implicite qu'on a fait depuis des décennies dans l'Education nationale, c'est de dire : on ne vous paye pas très bien, votre carrière est assez plate mais elle peut avoir des bonds quand vous passez le CAPES, quand vous passez l’agrég, mais vous avez des vacances et vous partez à la retraite avec un système qui est mieux calculé que chez beaucoup d'autres parce que c'est le système où on calcule sur la base des six derniers mois. […] Ca, c'est un peu le pacte social du corps enseignant. Ce pacte-là ne correspond plus à la réalité, ce qui est souhaitable je le dis très sincèrement. […]
Il faut repenser la carrière, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à ce que la carrière progresse davantage, qu'on ait un vrai dialogue avec l'ensemble des enseignants et leurs représentants pour dire comment on fait mieux progresser la carrière, comment on paye mieux. Comment, du coup, parce qu'on paye mieux, peut-être on change aussi le temps de travail et la relation au travail. Et je pense que les enseignants de votre génération y sont tout à fait prêts, et le font d'ailleurs bien souvent hors du temps scolaire, d'accompagner les jeunes différemment, que ce soit valorisé, que ça puisse être demandé aux enseignants, que le métier change, qu'on regarde aussi les périodes de vacances par rapport aux autres et puis qu'on pense sa carrière en valorisant beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui les périodes d'encadrement.»
Il faut repenser la carrière, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à ce que la carrière progresse davantage, qu'on ait un vrai dialogue avec l'ensemble des enseignants et leurs représentants pour dire comment on fait mieux progresser la carrière, comment on paye mieux. Comment, du coup, parce qu'on paye mieux, peut-être on change aussi le temps de travail et la relation au travail. Et je pense que les enseignants de votre génération y sont tout à fait prêts, et le font d'ailleurs bien souvent hors du temps scolaire, d'accompagner les jeunes différemment, que ce soit valorisé, que ça puisse être demandé aux enseignants, que le métier change, qu'on regarde aussi les périodes de vacances par rapport aux autres et puis qu'on pense sa carrière en valorisant beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui les périodes d'encadrement.»
Ces propos d’Emmanuel Macron à Rodez (le 03/10/2019) montrent bien ce qu’il a en tête : on augmente les profs mais, si et seulement si, on remet à plat le métier d’enseignant et ses « avantages » et on conditionne les augmentations à des "contreparties".
L’année précédente en 88, Lionel Jospin, ministre de l’éducation avait négocié la transformation des "instits" en professeurs des écoles avec une revalorisation des carrières et des rémunérations. On était donc bien dans une logique de contrepartie. Il pense alors pouvoir appliquer la même stratégie au second degré. Il s’agissait de mettre tout sur la table pour redéfinir le métier d'enseignant en même temps qu'on le revalorise. La conjoncture était favorable. Mais le syndicat majoritaire va s'opposer à cette logique. D'abord avec la crainte que cela soit une contrainte pour des profs très attachés à leur indépendance et qui refusent qu'on leur "impose" des réunions ou des tâches qui les éloigneraient de leur cœur de métier. Après plusieurs manifs et grèves, Jospin va capituler en aboutissant à une revalorisation de 20% sans que les négociations sur les obligations réglementaires de services (ORS), la référence aux temps de travail devant élèves et le statut n'aboutissent.
Depuis les travaux sur la définition du métier se sont succédés : rapport Thélot (2004) , rapport Pochard (2008), le rapport de la Cour des Comptes « Gérer les enseignants autrement » (2013) qui prône l’annualisation du temps de travail des enseignants.
En 2014-2015, sous l’impulsion du ministre Peillon, on produit un nouveau texte qui vise à remplacer les très sacralisés décrets de 1950, qui ne définissent le métier d’enseignant qu’aux seules heures de cours (dix-huit heures par semaine pour un certifié, quinze heures pour un agrégé).
Sans modifier le temps d’enseignement hebdomadaire, le décret inscrit dans le statut les missions liées à l’enseignement (préparation des cours, évaluation des élèves, orientation, travail collectif, etc.) et reconnaît les missions complémentaires effectuées au sein des établissements. Ces activités facultatives seront rétribuées par une indemnité.
L’autre volet de la réforme concernait la remise à plat du système de « décharges horaires » - ces réductions du nombre d’heures de cours dont bénéficient certaines catégories d’enseignants. Mais devant la levée de boucliers des profs de prépa contre la perte des heures liées à leur fonction, le projet n’a pas été au bout sur cet aspect.
Sans modifier le temps d’enseignement hebdomadaire, le décret inscrit dans le statut les missions liées à l’enseignement (préparation des cours, évaluation des élèves, orientation, travail collectif, etc.) et reconnaît les missions complémentaires effectuées au sein des établissements. Ces activités facultatives seront rétribuées par une indemnité.
L’autre volet de la réforme concernait la remise à plat du système de « décharges horaires » - ces réductions du nombre d’heures de cours dont bénéficient certaines catégories d’enseignants. Mais devant la levée de boucliers des profs de prépa contre la perte des heures liées à leur fonction, le projet n’a pas été au bout sur cet aspect.
Le rapport Brisson Laborde au Sénat en 2018 pointait l'occasion manquée de la révision des obligations réglementaires de service et faisait des propositions qui allaient dans le sens du Ministre. Celui-ci dans “L’Ecole de demain” (Odile Jacob, 2016), ouvrage programmatique publié un an avant sa prise de fonction défendait une « politique de ressources humaines qui valorise les qualités et les talents individuels de chaque professeur ». Il y décrivait un système d’affectation devenu « inadapté voire contre-productif ». « Une période de cinq années dans un même établissement paraît être un point d’équilibre », écrivait-il. Il évoquait aussi une possible refonte des obligations de service n’excluant pas une « annualisation du temps de travail » et une redéfinition du temps de vacances des enseignants.
On le voit à travers ce rapide retour en arrière, l’idée de contreparties à la revalorisation n’est pas neuve et obsède les gouvernants.
Impensés et autres idées fausses sur le métier enseignant
Le problème c’est que cette idée repose malheureusement sur un certain nombre d’implicites et préjugés qu’on peut lister rapidement :
Le problème c’est que cette idée repose malheureusement sur un certain nombre d’implicites et préjugés qu’on peut lister rapidement :
Les enseignants ne travaillent pas assez : c’est faux ! Il ne faut évidemment pas se focaliser sur le temps devant élèves : 15 heures par semaine pour les profs agrégés et 18 heures pour les certifiés dans les collèges et lycées. En primaire, un professeur des écoles (PE) a 24 heures de classe devant élèves, à quoi il faut ajouter 108 heures annuelles d’activités pédagogiques complémentaires, de réunions, conseils d’école, etc. Un PE français enseigne 924 heures par an, soit 152 heures de plus que la moyenne de l’OCDE.
Bien évidemment, qui peut imaginer qu’il suffit d’arriver en classe sans préparation et sans corrections faites ? Une étude de la DEPP datant de 2010 établit à 44 heures le temps de travail hebdomadaire d’un enseignant (52 heures pour les plus jeunes), soirées et weekend compris. Selon la même étude, un prof travaille 20 jours par an sur ses vacances.
Et on les paye cher ces vacances dans tous les sens du mot : en temps de cerveau disponible, en plein tarif et en préjugés négatifs... Rappelons que comme tout le monde, les enseignants ont cinq semaines de congés. Le reste ce sont les vacances des élèves. On l’a vu, une bonne partie de ces vacances est utilisée pour préparer ses cours, se former, etc.
Mais il est indéniable que la durée de ces vacances si ce n’est pas un privilège est un avantage de ce métier qui compense de moins en moins la faiblesse des salaires. Le remettre en question ne pourrait se faire sans une compensation financière.
Mais il est indéniable que la durée de ces vacances si ce n’est pas un privilège est un avantage de ce métier qui compense de moins en moins la faiblesse des salaires. Le remettre en question ne pourrait se faire sans une compensation financière.
Un dernier implicite réside dans la définition de ce qu’est le métier d’enseignant. L’idée que celui-ci se limiterait aux seules heures d’enseignement est dépassée depuis longtemps. Y compris chez les enseignants les plus réfractaires du second degré, il va de soi que le métier ne se limite pas à cela. Ces tâches, on les fait déjà !
C’est d'ailleurs pourquoi il serait symboliquement important de raisonner TTC (toutes tâches comprises) plutôt que de s’en tenir aux heures de cours et voir le reste comme de la surcharge de travail ou du superflu.
C’est d'ailleurs pourquoi il serait symboliquement important de raisonner TTC (toutes tâches comprises) plutôt que de s’en tenir aux heures de cours et voir le reste comme de la surcharge de travail ou du superflu.
Comment évaluer le mérite ?
Revenons sur les annonces faites par le ministre et à sa volonté déjà exprimée dans son livre programme. Sur les 500 millions annuels de hausse annoncée, seule une partie devrait être affectée à l'augmentation « universelle », la seconde moitié serait destinée aux profs “méritants” et à ceux qui seront d’accord pour… travailler plus.
On ferait rentrer là dedans un ensemble assez disparate : primes pour ceux qui assument des fonctions spécifiques, indemnisation pour ceux qui participeront à des formations pendant les vacances, mais aussi selon une appréciation assez vague, le mérite individuel.
Cette question de l’évaluation du mérite dans ce métier mériterait un billet spécifique. On se contentera ici de poser quelques questions.
- Comment évaluer un mérite individuel dans une mission qui est fondamentalement collective ?
- Sur quels indicateurs pourrait-on se baser ? Les résultats, l’appréciation des élèves/usagers, la « valeur ajoutée », les objectifs ?
- Qui déciderait de ce mérite ? un collectif ou le chef d’établissement manager ? Comment ne pas tomber dans le clientélisme ou la "note de gueule" ?
On le voit, les questions sont nombreuses et porteuses de multiples effets pervers. En Californie, l’instauration d’une rémunération au mérite pour les enseignants a été abandonnée car elle engendrait des tensions trop importantes au sein des collectifs de travail. Il faut se méfier de ce qui peut sembler une solution simple pour réguler un mécanisme complexe...
Comment mal redéfinir le métier
Les enseignants ne sont pas non plus des chasseurs de primes. Faudrait-il accumuler les tâches et autres responsabilités pour augmenter sa rémunération au risque de multiplier les « chefs » dans un métier avec une forte culture anti-hiérarchique ?
Pour le militant pédagogique que je suis, l'annualisation, la bivalence disciplinaire, la reconnaissance de la diversité des tâches, la formation (volontaire et choisie !) sur le temps de vacances, la constitution des équipes pédagogiques à l'échelle de l'établissement sont des nécessités qui mériteraient un vrai débat entre professionnels.
Mais pas dans la précipitation ni dans ce climat. Redéfinir le métier est une nécessité mais pas une urgence et pas sous la contrainte...
Lier une augmentation du salaire à des changements non concertés serait vécu comme un traité de dupes... La "transformation" du métier ressemblerait alors à un nouveau chantage assez emblématique de la conception du dialogue social de ce gouvernement.
Il y a suffisamment de raisons pour revaloriser vraiment le métier enseignant et lui redonner du pouvoir d’achat, de l’attractivité, du pouvoir d’agir et de la considération pour éviter de tomber dans le piège du « travailler plus pour gagner plus »
Philippe Watrelot
[ce texte a été initialement publié sur le site d'Alternatives Économiques ]
----------------------

Chronique éducation de Philippe Watrelot est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.